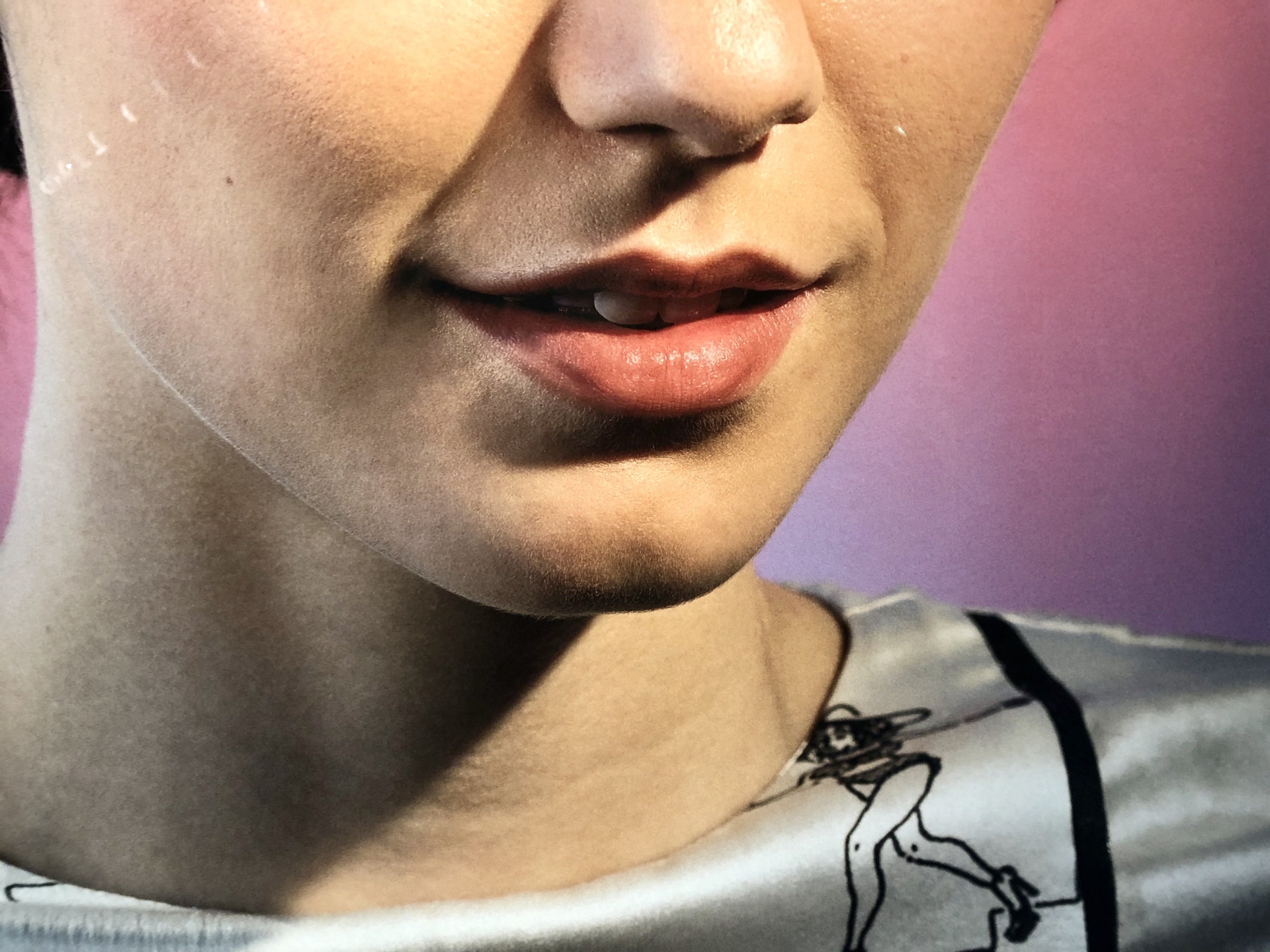On a voulu, par une manœuvre tout à fait sophistique, opposer la laïcité au féminisme, en expliquant qu’au nom de la laïcité on privait certaines femmes de la liberté de se vêtir comme elles le voulaient.
Cet argument pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, personne n’est privé de la liberté de se vêtir comme il veut. Les signes religieux sont seulement interdits dans certains espaces officiels ou publics, et pas dans tous les espaces publics, heureusement. C’est donc une restriction qui n’est pas une interdiction et qui ne concerne personne spécifiquement : aucun symbole religieux n’a davantage sa place qu’un autre. Les manifestations ostensibles d’appartenance religieuse n’ont tout simplement pas leur place dans les bâtiments et les institutions de la République.
On a donc voulu penser que la laïcité privait les femmes de leur libre choix en les empêchant de s’habiller comme elles voulaient : à cela on peut opposer deux catégories d’objection, une « faible » et une autre que je pense plus « forte ».
Prenons l’exemple du burkini : en 2016, des polémiques sont nées autour de ce vêtement apparu sur les plages de France. Certains policiers et maires ont d’abord cru bon de verbaliser les femmes qui le portaient, avant que le Conseil d’État n’estime que ces contraventions n’avaient pas lieu d’être. La polémique s’est alors arrêtée, tout simplement parce que les gens qui demandaient aux femmes de mettre un burkini pour aller à la plage ne le demandaient pas pour que les femmes puissent exercer un droit dont elles sont ordinairement privées. Ils le demandaient pour que ces femmes reçoivent des contraventions, ce qui leur permettait ensuite de se présenter comme les victimes d’une République oppressive. À partir du moment où le Conseil d’État a déclaré que chacun pouvait se baigner dans la tenue qu’il souhaitait, il n’y a plus eu de problème et, surtout, il n’y a plus eu de burkini.
Autrement dit, le fait que des vêtements soient, à mon avis, le symbole du patriarcat et de l'oppression de la femme par l’homme, n’autorise pas à les interdire. On lutte mal contre un tel vêtement (qui est un symbole de soumission) en l’interdisant: l’enjeu est précisément, en luttant contre le burkini, de lutter contre une société où l’on pourrait interdire un vêtement au nom de sa signification. Par conséquent, être contre le burkini c’est être contre son interdiction. Je préfère un monde où le burkini est légal en France et le string légal en Iran, qu’un monde où les deux sont interdits.
Que faire de celle ou celui qui, librement, désire se soumettre ? Un démocrate ne peut pas juger des intentions. Il ne juge que de la qualité des demandes qui lui sont adressées. C’est, par exemple, le dilemme que rencontre Daenerys dans « Game of Thrones ». Cette dernière conquiert la ville de Meereen dont elle libère tous les esclaves. Mais, quelques jours plus tard, l’un d’eux demande à redevenir esclave, car il considère que lorsqu’il était esclave il avait au moins de quoi se nourrir. Daenerys se demande alors si elle doit l’autoriser à redevenir esclave, même si c’est en contradiction avec l’idée qu’elle se fait de sa propre entreprise de libération des peuples asservis : si elle le lui permet, sa démarche n’aura servi à rien, si elle le lui interdit, elle se met en contradiction avec sa raison d’agir, qui est la liberté de chacun. Après avoir hésité, elle tranche en faveur de la liberté paradoxale de se soumettre : avec le burkini, il faut en faire autant, sous peine de penser à la place des autres et de fournir aux islamistes un nouvel argument pour se victimiser.
Cela dit, le véritable problème n'est pas que les femmes n'aient pas le droit de se voiler ! Elles en ont le droit dans le monde entier. Le problème est que, dans certaines parties du monde, les femmes ne se dévoilent pas sans être décapitées ou emprisonnées. Si l’on considère que le problème est le sort des femmes voilées, qui ont exactement les mêmes droits que tout le monde sous un ciel républicain, alors on oublie que le seul et véritable problème est le sort des femmes à Téhéran (ou à Riyad, c’est à peu près pareil) qui finissent en prison parce qu’elles ont osé montrer un bout de cheveu. C’est la raison pour laquelle, selon moi, il n’existe pas de féminisme religieux, d’une manière ou d’une autre. Aucun monothéisme n’est féministe. Tous ont en commun de mettre la femme sur un piédestal, tout en la privant de liberté. Et c’est aussi la raison pour laquelle la laïcité s’oppose frontalement à l’intersectionnalité, car l’intersectionnalité (qui se présente avantageusement, au départ, comme la convergence des luttes sociale, féministe et antiraciste) produit des discours où le féminisme est, en définitive, minoré au profit de l’antiracisme. Ainsi, chez les intersectionnels qui voient du racisme jusque dans le blasphème, la crainte d’être islamophobe l’emporte sur la défense de l’égalité des femmes et, par conséquent, on se trouve aujourd’hui dans une situation où, au nom de la convergence des luttes, on sacrifie une lutte à une autre. Le paradoxe de la laïcité est qu’elle ne parle pas du tout de convergence des luttes mais qu’en circonstance elle n’en sacrifie aucune. Sous un ciel laïque, le racisme n’a pas plus sa place que la misogynie. En revanche, en vertu d’un double paradoxe, sous un ciel intersectionnel la misogynie religieuse a toute sa place, au nom de la tolérance.